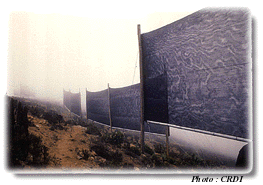 |
Les technologies à faible coût |
Un besoin croissant
Des
technologies adaptées aux besoins des pays en développement
Des technologies ingénieuses
Un effet d’entraînement
Des
innovations avantageuses pour les pays industrialisés
Des marais épurateurs
Le traitement par la tourbe
Échanges d’expertises
Un réseau tourné
vers l’avenir
Références
"À
Chungungo, au Chili, petit village situé dans une des régions les plus
arides du monde, l'eau est une denrée précieuse. Transportée par camion
en provenance de puits éloignés, il a longtemps été normal de l'utiliser
au compte-gouttes. D'un coût très élevé, l'eau, 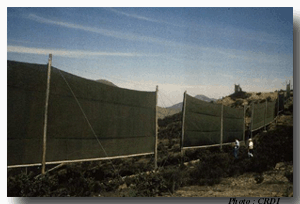 souvent
contaminée, était responsable des piètres conditions hygiéniques, de la
prolifération de maladies et de l'insuffisance de la production alimentaire.
Aujourd'hui, grâce à une technique toute simple, on peut recueillir l'eau
contenue dans le brouillard et fournir aux villageois deux ou trois fois
plus d'eau qu'ils n'en utilisaient auparavant et ce, à meilleur marché.
L'épais brouillard (camanchaca), qui s'étend presque en permanence le
long de la côte du Chili et crée des nappes de brumes tenaces quand les
vents dominants soufflent de la mer et franchissent les montagnes, rend
possible le recours à cette technique." (CRDI,
http://www.idrc.ca/nayudamma/fogcatc_72f.html)
souvent
contaminée, était responsable des piètres conditions hygiéniques, de la
prolifération de maladies et de l'insuffisance de la production alimentaire.
Aujourd'hui, grâce à une technique toute simple, on peut recueillir l'eau
contenue dans le brouillard et fournir aux villageois deux ou trois fois
plus d'eau qu'ils n'en utilisaient auparavant et ce, à meilleur marché.
L'épais brouillard (camanchaca), qui s'étend presque en permanence le
long de la côte du Chili et crée des nappes de brumes tenaces quand les
vents dominants soufflent de la mer et franchissent les montagnes, rend
possible le recours à cette technique." (CRDI,
http://www.idrc.ca/nayudamma/fogcatc_72f.html)
En Inde, il n’y a pas si longtemps, la population d’Akole Taluka, zone tribale du centre du pays, devait passer la plupart de son temps à chercher de l’eau pour son usage quotidien. Une nouvelle stratégie de gestion de l’eau a permis son accès à longueur d’années avec des surplus pour irriguer la terre, autrefois inculte. En Malaisie, l’installation de pompes à main le long de l’autoroute a permis d’approvisionner en eau les voyageurs.
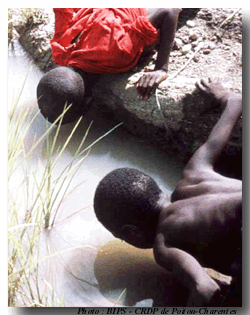 "1,5
milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable dans le
monde (le quart de la population mondiale), et plus de 2 milliards de
personnes ne disposent pas d’un assainissement approprié."
(RéFEA, http://www.oieau.fr/ReFEA/module1.html).
Alors qu’au Québec, nous utilisons en moyenne 420 litres d’eau
par personne chaque jour, dans plusieurs pays du Sud c’est seulement
une trentaine de litres par personne par jour qui sont disponibles, tandis
que dans certains pays du Sahel, on arrive difficilement à trouver 10
litres d’eau. Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), 30 litres d’eau seraient le minimum
nécessaire à une personne pour vivre. De plus, avec l’augmentation
rapide de la population, la quantité d’eau disponible par personne
s’en trouvera réduite. Ainsi, on prévoit que près de 65 pays (7 milliards
de personnes) manqueront d’eau d’ici 2050, soit 65 % de la population
mondiale.
"1,5
milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable dans le
monde (le quart de la population mondiale), et plus de 2 milliards de
personnes ne disposent pas d’un assainissement approprié."
(RéFEA, http://www.oieau.fr/ReFEA/module1.html).
Alors qu’au Québec, nous utilisons en moyenne 420 litres d’eau
par personne chaque jour, dans plusieurs pays du Sud c’est seulement
une trentaine de litres par personne par jour qui sont disponibles, tandis
que dans certains pays du Sahel, on arrive difficilement à trouver 10
litres d’eau. Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), 30 litres d’eau seraient le minimum
nécessaire à une personne pour vivre. De plus, avec l’augmentation
rapide de la population, la quantité d’eau disponible par personne
s’en trouvera réduite. Ainsi, on prévoit que près de 65 pays (7 milliards
de personnes) manqueront d’eau d’ici 2050, soit 65 % de la population
mondiale.
L’industrialisation, l’urbanisation et l’agriculture intensives ont entraîné une importante détérioration de la qualité des eaux des pays en développement. 80 pour cent des maladies présentes dans ces pays sont dues à la piètre qualité de l’eau. Les bactéries et virus présents dans l’eau sont vecteurs de maladies comme le choléra, la fièvre typhoïde, la dysenterie ou l’hépatite infectieuse qui causent la mort d’environ 34 000 personnes par jour dans le monde (autant que l’écrasement de 100 gros porteurs par jour).
![]() Des technologies
adaptées aux besoins des pays en développement
Des technologies
adaptées aux besoins des pays en développement
Plusieurs organismes, comme le CREPA (Centre régional pour l’eau potable et l’assainissement à faible coût), basé à Ouagadougou, et le CRDI (Centre canadien de recherche pour le développement international) se sont donnés pour mandat pour les années 2000 d’augmenter l’approvisionnement en eau et l’assainissement des pays en développement. On a longtemps utilisé des technologies qui n'étaient pas adaptées à leurs conditions, des technologies souvent conçues dans les pays du nord pour les pays du sud. Elles se sont souvent révélées, trop complexes, non conçues pour des conditions difficiles et des usages intensifs. Plusieurs d’entre elles, comme les anciennes pompes à main, sont restées à l’abandon après qu’elles se soient brisées et que les pièces de rechange, parce que trop dispendieuses ou difficiles à obtenir, n’aient pas été trouvées. De plus, les technologies utilisées dans les pays du nord sont difficilement exportables vers les pays du sud. Souvent complexes elles aussi, elles sont également trop coûteuses, les coûts d’investissement et de fonctionnement ne pouvant être assumés. Plusieurs méthodes comme celles de l’analyse de l’eau nécessitent l’expertise de techniciens hautement compétents et des laboratoires perfectionnés. Elles ne tiennent souvent pas compte du manque de formation des exploitants.
Les pays en développement ont besoin de technologies adaptées à leur situation économique, sociale et environnementale. Heureusement aujourd’hui, les innovations abondent dans ce sens et de nombreuses technologies à faible coût comme certains les appellent ont été développées. Ce sont des technologies qui demandent, avant même leur mise sur pied, une bonne connaissance du milieu et des ressources disponibles sur place. Dans le Deccan, en Inde centrale, on a élaboré une nouvelle stratégie de gestion de l’eau qui, grâce à une variété de techniques, met à profit les eaux souterraines. On a entre autres creusé des fossés et érigé des barrières de roches pour colmater des ravines et des ruisselets. On a dû au préalable, acquérir des connaissances sur l’hydrogéologie du sol et des eaux souterraines, du climat, etc.. On s’est de plus assuré de la participation de la populations locale à chaque phase du projet.
Le RéFEA (Réseau Francophone sur l’Eau et l’Assainissement) a identifié trois qualités qui font qu’une technologie - que ce soit pour l’analyse de l’eau, pour son traitement ou pour l’assainissement - est plus appropriée qu’une autre: elle utilise la main d’œuvre locale pour la construction et encourage les petites industries; elle utilise des matériaux, équipements et techniques de construction que la population locale connaît; elle repose sur des matières premières disponibles sur le plan local et des composantes manufacturées. Le RéFEA souligne l’importance de bien informer la communauté à propos de la maintenance, des implications financières de chacune des options qui leur sont offertes afin qu’elle fasse un choix éclairé puisque c’est à la communauté que doit incomber la décision finale.
Pour rencontrer ces différents critères, en plus d’être peu coûteuses, ces technologies doivent souvent faire preuve d’une grande ingéniosité et d’adaptation au milieu. Au Liban, par exemple, des chercheurs de l’Université américaine de Beyrouth avec l’aide du CRDI se sont inspirés de méthodes de traitement de l’eau qui avaient cours en Inde 2000 ans avant Jésus-Christ pour mettre au point un moyen pratique et peu coûteux d’approvisionner en eau potable les populations des pays en développement. Il s’agit d’orienter l’eau par rapport au soleil de façon qu’il détruise les bactéries qui y sont présentes. Les longueurs d’onde de la lumière solaire les plus efficaces pour détruire les bactéries sont celles comprises entre 315 et 400 nanomètres (ultraviolet). Le verre et le plastique transparents sont des matériaux qui laissent entrer une lumière qui se rapproche le plus de ce spectre et qui offrent ainsi un bon pouvoir de désinfection. Finalement, des recherches effectuées récemment à Montréal ont démontré que les sacs de plastique transparent sont ce qui convient le mieux à la désinfection de l’eau par rayonnement solaire. Voilà un exemple de technique simple et peu coûteuse ! Selon les informations recueillies sur le site du CRDI, six litres d’eau du Saint-Laurent peuvent ainsi être désinfectés en cinq heures durant l’été. L’utilisation d’une énergie renouvelable comme le soleil, une ressource à la fois abondante et accessible s’avère une alternative très souvent intéressante.
La mise sur pied de technologies à faible coût, en plus d’améliorer les conditions de santé et de qualité de vie, a souvent un effet d’entraînement dans une communauté. Encourager l’implication des personnes sur place augmente leur sentiment de prise en charge et de responsabilité. Des emplois sont ainsi créés, des gens sont formés, vont chercher une plus grande expertise et sont souvent par la suite invités à transmettre leur savoir-faire à d’autres communautés. Les gens deviennent mieux informés et plus sensibilisés aux pratiques plus hygiéniques et modifient leurs comportements à risques.
 À Chungungo au Chili, on a installé 80 capteurs de
brouillard, de grands filets en polypropylène semblables à de gigantesques filets de
volley-ball, destinés à recueillir les fines gouttelettes d’eau contenues dans
l’épais brouillard qui s’étend presque en permanence le long de la côte. En
plus de recueillir une eau de très bonne qualité, les villageois sont maintenant
approvisionnés deux à trois fois plus en eau qu’ils n’en utilisaient
auparavant et ce, à meilleur marché. Un approvisionnement en eau plus fiable et sans
danger a non seulement contribué à l’amélioration de la santé mais a aussi
haussé le niveau de revenu de la population. Aujourd’hui, le réseau
d’adduction d’eau de Chungungo est entièrement administré par la
collectivité, et le village, auparavant pauvre, tire maintenant profit des retombées du
système. L’électricité y a été installée, un nouveau secteur touristique a
été érigé, appelé Villa Canadá, et on y attire même des vacanciers !
À Chungungo au Chili, on a installé 80 capteurs de
brouillard, de grands filets en polypropylène semblables à de gigantesques filets de
volley-ball, destinés à recueillir les fines gouttelettes d’eau contenues dans
l’épais brouillard qui s’étend presque en permanence le long de la côte. En
plus de recueillir une eau de très bonne qualité, les villageois sont maintenant
approvisionnés deux à trois fois plus en eau qu’ils n’en utilisaient
auparavant et ce, à meilleur marché. Un approvisionnement en eau plus fiable et sans
danger a non seulement contribué à l’amélioration de la santé mais a aussi
haussé le niveau de revenu de la population. Aujourd’hui, le réseau
d’adduction d’eau de Chungungo est entièrement administré par la
collectivité, et le village, auparavant pauvre, tire maintenant profit des retombées du
système. L’électricité y a été installée, un nouveau secteur touristique a
été érigé, appelé Villa Canadá, et on y attire même des vacanciers !
![]() Des innovations
avantageuses pour les pays industrialisés
Des innovations
avantageuses pour les pays industrialisés
Les technologies à faible coût n’entraînent pas des bénéfices qu’aux pays en développement. Les pays industrialisés peuvent aussi tirer des avantages de technologies simples et peu coûteuses. La communauté crie de Split lake, au Manitoba, aux prises avec des problèmes de santé causés par l’eau, a établi, avec l’aide du CRDI, son propre laboratoire d’analyse d’eau faisant appel à des techniciens locaux et à des tests simples trouvés à la suite de recherches effectuées en Asie, en Afrique et en Amérique latine.
Au Québec, les innovations se sont faites plutôt au niveau de l’assainissement. La plupart des moyennes et grandes municipalités sont maintenant dotées de stations d’épuration. Mais parmi les municipalités de moins de 4000 habitants, plusieurs rejettent encore leurs eaux usées sans traitement dans les cours d’eau avoisinants. Les procédés utilisées par les grandes agglomérations sont souvent mal adaptés et inabordables pour les petites communautés souvent dispersées, difficiles d’accès ou éloignées. Plusieurs réseaux d’égouts existant au Québec ne sont pas conçus pour acheminer l’eau à une station d’épuration. Les eaux de pluies s’additionnent la plupart du temps aux eaux d’égouts, ce qui entraîne de grands volumes d’eau à traiter et nécessite des installations importantes associés à des coûts de construction et d’exploitation faramineux. Des technologies mieux adaptées à la réalité des petites localités sont donc nécessaires.
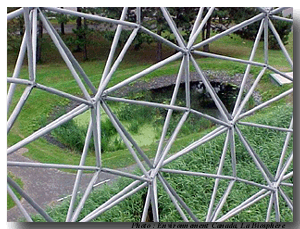 Une de ces technologies est de plus en plus répandue
au Québec. Il s’agit du traitement par
marais artificiel. Les milieux humides ont la propriété d’être de bons
épurateurs naturels. Les plantes - comme les roseaux et les quenouilles - et les
bactéries captent les phosphates, l’azote et les produits toxiques en plus de
retenir les sédiments en suspension dans l’eau. C’est un procédé qui comporte
plusieurs qualités qui en font une solution avantageuse pour les petites agglomérations
et les installations isolées. Ce système est simple et efficace, nécessite très peu de
coûts de construction et d’opération en plus de bien s’intégrer aux paysages
ruraux et urbains. La Biosphère, la plage de l’Île Notre-Dame, le zoo de
Saint-Félicien ainsi que plusieurs municipalités utilisent ce procédé. Ils sont
également de plus en plus nombreux à adapter cette technique dans le milieu agricole.
Une de ces technologies est de plus en plus répandue
au Québec. Il s’agit du traitement par
marais artificiel. Les milieux humides ont la propriété d’être de bons
épurateurs naturels. Les plantes - comme les roseaux et les quenouilles - et les
bactéries captent les phosphates, l’azote et les produits toxiques en plus de
retenir les sédiments en suspension dans l’eau. C’est un procédé qui comporte
plusieurs qualités qui en font une solution avantageuse pour les petites agglomérations
et les installations isolées. Ce système est simple et efficace, nécessite très peu de
coûts de construction et d’opération en plus de bien s’intégrer aux paysages
ruraux et urbains. La Biosphère, la plage de l’Île Notre-Dame, le zoo de
Saint-Félicien ainsi que plusieurs municipalités utilisent ce procédé. Ils sont
également de plus en plus nombreux à adapter cette technique dans le milieu agricole.
L’utilisation de la tourbe est un autre moyen de traiter les eaux usées. Ce procédé est particulièrement approprié pour les installations isolées. Il s’appuie sur la présence d’une importante activité microbienne et sur sa capacité accrue de rétention et d’absorption des liquides. L’entreprise Premier Tech Inc. a mis au point un système de biofiltration utilisant ce procédé, qui a été commercialisé depuis 1994 sous le nom d’Écoflo. Il consiste en un caisson en fibre de verre contenant un lit filtrant à base de tourbe. Les eaux à traiter de la maison sont acheminées de la fosse septique vers le caisson pour ensuite s’infiltrer dans le sol ou être diluées dans le cours d’eau.
Il n’est pas rare que les technologies développées ici connaissent un essor international. C’est le cas de l’Écoflo, maintenant exporté en Ontario, aux États-Unis et en France. Mais c’est aussi l’échange d’expertise qui découlent de la création ou de l’utilisation d’une de ces technologies qui en font une alternative intéressante. Ce fut le cas des Cris du Manitoba qui, suite à l’élaboration de leur système d’analyse de l’eau, ont élaboré un programme de formation donné par les techniciens cris aux membres de deux communautés autochtones du Chili, les Mapuches. Un atelier d’échange a aussi permis de faire connaître les tests à des participants du Costa Rica, du Guatemala et du Nicaragua. Et ça continue...
Les échanges vont aussi dans le sens inverse, c’est à dire des pays du sud vers d’autres pays aux prises avec des problèmes similaires. Ainsi, des cours d’une durée de dix jours ont été organisés à Chungungo au Chili afin de favoriser la transmission d’expertise concernant les capteurs de brouillard. On retrouve maintenant des capteurs en Équateur, au Pérou et en Namibie.
L’utilisation de technologies simples et peu coûteuses semblent non seulement être une solution avantageuse pour les pays en développement et pour les petites agglomérations des pays du nord, mais leurs qualités en font une alternative facilement adaptable dans plusieurs parties du monde en plus de favoriser l’entraide entre les communautés des différents pays.
![]() Un réseau tourné vers l’avenir
Un réseau tourné vers l’avenir
![]() Le CRDI a créé un réseau scolaire international d’étude sur
la pollution de l’eau, Aquatox 2000, qui réunit de jeunes élèves chercheurs d’une
trentaine de pays à travers le monde, dont le Canada. Il permet d’acquérir et
d’échanger de l’information sur la qualité de l’eau de plusieurs points
du globe. Avec l’aide d’une équipe internationale de scientifiques qui oeuvrent
dans des laboratoires d’analyse de la qualité de l’eau, ils utilisent des
séries d’analyses simples peu coûteuses pour mesurer le degré de pollution dans
l’eau de leur milieu. Parmi ces tests, on retrouve celui de l’étude de la
germination de bulbes d’oignon dont la longueur de la racine sert d’indice de
toxicité et l’analyse de semences de laitue dont l’indice de toxicité est
relié à l’absence de croissance des pousses et de leurs racines.
Le CRDI a créé un réseau scolaire international d’étude sur
la pollution de l’eau, Aquatox 2000, qui réunit de jeunes élèves chercheurs d’une
trentaine de pays à travers le monde, dont le Canada. Il permet d’acquérir et
d’échanger de l’information sur la qualité de l’eau de plusieurs points
du globe. Avec l’aide d’une équipe internationale de scientifiques qui oeuvrent
dans des laboratoires d’analyse de la qualité de l’eau, ils utilisent des
séries d’analyses simples peu coûteuses pour mesurer le degré de pollution dans
l’eau de leur milieu. Parmi ces tests, on retrouve celui de l’étude de la
germination de bulbes d’oignon dont la longueur de la racine sert d’indice de
toxicité et l’analyse de semences de laitue dont l’indice de toxicité est
relié à l’absence de croissance des pousses et de leurs racines.
En touchant les jeunes, le réseau se tourne vers l’avenir. Tout en les encourageant à la protection de l’eau et de l’environnement dans leur milieu, qu’ils soient canadiens, ivoiriens ou ukrainiens, les jeunes sont sensibilisés à l’importance de la contribution de la recherche scientifique pour un avenir durable sur l’ensemble de la planète.
Agence canadienne de développement local (ACDI). L’eau et le développement durable, le 22 mars : Journée mondiale de l’eau, chaque goutte est précieuse, [Ottawa], ACDI, 1996, 26 p.
Caicedo, Silvia. Aquatox 2000 , International School Network on Water Toxicity : Technical Report for IDRC Awards Unit and the Ecosystem Approaches to Human Health Program Initiative, Ottawa, s.n., novembre 1999, 45 p.
Centre de recherches pour le développement international, " Aquatox 2000, Réseau scolaire international d’étude sur la pollution de l’eau ", s.l., s.n., s.p.
Centre de recherches pour le développement international (CRDI). Banque d'information Nayudamma. [En ligne]. http://www.crdi.ca/nayudamma/index_f.html (Page consultée le 3 août 2000).
Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement à faible coût (CREPA). [En ligne]. http://www.oieau.fr/crepa/ (Page consultée le 3 août 2000).
Marois, Nathalie. " Des innovations pour l’assainissement des eaux de petites collectivités ". L’Enjeu, (printemps 1997), p. 25-28.
Réseau francophone sur l'eau et l'assainissement. Centre télématique francophone sur l'eau. [En ligne]. http://www.oieau.fr/ReFEA/ (Page consultée le 3 août 2000).
| La
Biosphère Dernière mise à jour: 2000-10-31 URL de cette page: http://biosphere.ec.gc.ca/cea/actu/doss/doss_00031_f.html Droits d'auteur © 2000, Environnement Canada Tous droits réservés. |
|
| |
|